Chaque sortie chez le·la vétérinaire pour mes chats s’accompagne d’une double l’angoisse : 1) mon chat va-t-il enfin se sentir mieux ? Et 2) combien cela va-t-il encore me coûter ? Le prix des consultations vétérinaires et des traitements prescrits est si rédhibitoire que c’est à se demander si les gens ayant peu de moyens et qui prennent vraiment soin de la santé de leur animal, ne mériteraient pas la légion d’honneur. D’ailleurs bien souvent, le prix de la santé de leur compagnon animal dissuadent malheureusement beaucoup de propriétaire d’animaux d’aller chez le vétérinaire pour faire le nécessaire.
Face à ce constat, je me suis dit l’autre jour, en sortant d’une consultation à trois chiffres, qu’une bonne solution serait d’étendre le régime général de la sécurité sociale aux animaux de compagnie. On ferait ainsi d’une pierre deux coups : on garantirait au mieux nos devoirs envers nos compagnons animaux en matière de santé, et en prime on rendrait définitivement chauves les chantres néolibéraux du « trou de la sécu » ! Mais comment justifier une telle nécessité ? Je vous propose quelques petits détours philosophiques avant de revenir à notre sécu animaliste.
1) Pourquoi s’intéresser aux animaux de compagnie ?
Les animaux de compagnie ont rarement eu le vent en poupe du côté des intellectuel·le·s. Certes, le récent Manifeste des espèces compagnes de Donna Harraway – voir l’article Berthine à ce sujet – pourrait contribuer à leur donner une visibilité sur les bancs des facs de philo anglo-saxonnes. Mais pour le reste les philosophes ont largement ignoré voire méprisé la question. C’est ainsi que dans un accès soudain de discipline intellectuelle Deleuze et Guattari nous livre une pensée tout aussi subtile que réfléchie qui fait honneur à la philosophie française : « Tous ceux qui aiment les chats, les chiens sont des cons » (Mille plateaux, Éditions de minuit, 1980, p.240). Et on serait bien en peine de trouver quelque chose qui ressemble à une argumentation étayant cette saillie dans le reste du livre. Et ils ne sont pas les seuls à voir dans cette manie humaine de cajoler des animaux triés sur le volet (chiens et chats globalement), un puissant révélateur des névroses collectives inhérentes aux sociétés de consommation modernes, dans lesquelles des humains robotisés et esseulés par une vie de labeur effrénée, trouvent dans leurs amis à poil la seule consolation suffisante pour combler le vide affectif de leur existence.
Et pourtant, cette thèse sociologique à la mode se montre bien peu convaincante au regard de l’histoire millénaire des relations des humains aux animaux de compagnie. Contrairement à un préjugé tenace – et même si leur nombre a explosé ces derniers siècles, en même temps que la population humaine du reste – les animaux de compagnie ne sont pas d’anciens animaux domestiques « utilitaires » que le progrès techniques récent aurait rendu inutiles, et que l’on aurait alors converti bon gré mal gré en boules à câlins. Toutes les formes de société humaine depuis des millénaires ont eu des animaux de compagnie « inutiles ».
Les Grecs et les Romains avaient de nombreux animaux, parfois exotiques, auxquels ils donnaient des noms et auxquels ils accordaient une valeur précieuse. Alexandre le Grand aurait même fondé deux villes en l’honneur de ses amis à quatre pattes : Bucéphalie en l’honneur de son cheval ; et Péritas à la mémoire de son chien.
Des sociétés de chasseurs-cueilleurs apprivoisent de nombreux animaux, bien souvent les petits des animaux tués à la chasse, et les élèvent presque comme des enfants de la maison, sans jamais les manger ni les exploiter. C’est le cas par exemple des Achuar du Brésil décrits par l’anthropologue Philippe Desola dans Par-delà nature et culture (2000). L’hypothèse serait que l’apprivoisement d’un animal de compagnie ferait partie du panel de pratiques censées compenser symboliquement la violence de l’acte de chasse. Par des pratiques rituelles et le soin apporté à un animal appartenant à l’espèce chassée, les Achuar espèrent que leur gibier et l’esprit qui l’incarne leur pardonnera leur prédation, et se montrera indulgent à l’avenir en leur offrant de nouveaux animaux. Il est ainsi suggestif d’étendre l’hypothèse à nos sociétés : serait-ce par mauvaise conscience à l’égard des milliards d’animaux tués et exploités que nous apportons tant d’amour à nos animaux de compagnie ?
Bien plus sérieuses que les élucubrations d’intellectuels français en vogue sur les névroses des amoureux des chiens et chats, il faut également prendre en considération le silence des grandes philosophies de l’éthique animale sur la question spécifique des animaux de compagnie. Ni Peter Singer dans la Libération animale, ni Tom Regan dans Les Droits des animaux – pour prendre les deux ouvrages classiques de référence – ne se penchent particulièrement sur leur sort, préférant traiter de l’élevage ou de l’expérimentation sur les animaux. Et on les comprend : il semble bien plus urgent de démontrer que ces pratiques sont criminelles et font mortellement souffrir des milliards d’animaux, et que nous avons par conséquent des devoirs impérieux envers eux. Notre traitement des animaux de compagnie semble poser des problèmes moraux moins graves et moins urgents, quoique réels. Les animaux de compagnie sont somme toute des privilégiés parmi les animaux, leur cause attendra.
Néanmoins, une autre approche de l’éthique animale serait possible, qui partirait du sort privilégié des animaux de compagnie, afin de l’approfondir et ensuite de l’appliquer aux autres animaux. Et si nous nous demandions d’abord : quels droits mon chien devrait-il avoir ? Et puis ensuite : Faut-il donner les droits de mon chien à tous les animaux ? Voilà une piste de recherche intéressante pour la philosophie animaliste.

2) Faut-il continuer à les faire vivre ?
Intéressons-nous donc au statut des animaux de compagnies, à nos devoirs et à leurs droits, d’après les théories en éthique animale qui se sont penché sur la question.
Pour résumer le débat, on peut dire que deux positions se disputent sur une question cruciale : faut-il oui ou non continuer à domestiquer et à vivre avec des animaux de compagnie, alors que leur existence même est le résultat de processus de sélection qui les ont rendu complètement dépendants de nous ? Certains – qu’on appelle les abolitionnistes / extinctionnistes – recommandent de prendre soin des animaux déjà nés, mais de viser leur extinction à terme grâce à une stérilisation massive. Ils appliquent ce raisonnement aussi bien aux animaux de compagnie qu’aux espèces domestiquées pour l’exploitation et la consommation. Ainsi Gary Francione : « Les animaux domestiques sont dépendants de nous : nous décidons s’ils mangeront et quand ils le feront, s’ils auront de l’eau, où et quand ils pourront faire leur besoins, quand ils dormiront, s’ils pourront ou non faire de l’exercice, etc. (…) Ils sont condamnés à l’enfer de la vulnérabilité et dépendent de nous pour la satisfaction du moindre de leurs besoins vitaux. Nous les avons élevés de manière à les rendre dociles et serviles, ou pour qu’ils développent certaines caractéristiques que nous trouvons plaisantes mais qui leur porte préjudice. Bien sûr, nous pouvons essayer de les rendre heureux, mais la relation que nous établissons avec eux ne peut jamais être « naturelle » ou « normale ». » Et Francione poursuit de façon touchante mais un peu pathétique en disant que même s’il adore vivre avec ses cinq chiens, il pense que les chiens doivent disparaître afin que plus aucun chien ne soit contraint de vivre dans le système d’oppression que nous leur imposons.
Pendant longtemps, j’avais confusément tendance à penser comme Francione. Je me disais que nos relations aux animaux de compagnie sont forcément le fruit de l’oppression, quand bien même on ne voudrait que leur bien. Quand on lit la servilité et la soumission dans le regard d’un chien, me disais-je, on ne peut pas penser qu’une relation d’amour et de justice saine peut s’établir entre lui et nous. Et puis j’ai lu l’ouvrage Zoopolis, dans lequel Sue Donaldson et Will Kymlicka critiquent les implications de la position de Francione.
Première critique, Francione et les extinctionnistes présupposent que seule une vie sauvage et indépendante est digne d’être vécue pour les animaux. Ce présupposé repose sur une vision idéalisée et romantique de la nature sauvage, et surtout, il signifie que vivre sous la dépendance d’autrui serait mauvais en soi. Or, au-delà des animaux de compagnie, de nombreuses personnes humaines vivent de façon dépendante à divers degrés, qu’il s’agisse des enfants, des personnes handicapées, voire de tout être humain qui dépend des autres affectivement et de la société toute entière pour répondre à ses besoins matériels et sociaux. La philosophie animaliste doit donc se défaire du préjugé de l’indépendance comme condition sine qua non du bonheur.
Deuxième critique : l’extinction exige de recourir à des moyens qui sont coercitifs à l’égard des animaux : la stérilisation massive et forcée constitue en soi une violation de leurs droits fondamentaux. Francione veut ainsi supprimer l’oppression par un moyen lui-même oppressif. Au nom de quel étrange sens de la justice antispéciste pourrait-on stériliser les animaux de compagnie, sans leur demander leur avis, soit disant pour leur bien, et en même temps considérer comme totalitaire un État qui voudrait faire la même chose avec sa population humaine ?
Troisième critique, la plus intéressante je trouve : les transformations physiques et comportementales des espèces domestiquées relèvent de la néoténie. Cela veut dire que par rapport au loup sauvage, le chien domestique présente des caractéristiques juvéniles : instinct de jeu pérenne à l’âge adulte ; moins d’agressivité et de méfiance ; dépendance affective accrue. Les extinctionnistes voient dans ces transformations une régression qui condamnent les animaux à une vie mutilée. Ce faisant, ils passent à côté de deux faits : 1) le fait que la néoténisation implique aussi des comportements positifs : une plus grande faculté d’adaptation au changement, une plus forte capacité à sociabiliser avec plusieurs espèces. 2) le fait que l’évolution humaine a également suivi une trajectoire de néoténisation, qui implique certes un recul de certaines facultés physiques, mais une plus grande sociabilité et un comportement plus pacifique. Pourquoi alors ce que nous appelons méliorativement sociabilité chez l’humain devrait être considéré péjorativement comme de la servilité ou de la dépendance chez l’animal non humain ?
En somme, Donaldson et Kymlicka refusent de considérer que le meilleur moyen de réparer une oppression passée à l’égard d’une population soit tout simplement de supprimer cette population (imaginez qu’on ait proposé la même solution aux États-Unis pour les esclaves, au lieu de tout simplement en faire des citoyens à part entière !) ; et ils défendent plutôt l’idée que, moyennant des améliorations significatives dans leurs droits et la façon dont nous les traitons, plusieurs espèces animales peuvent très bien vivre une vie épanouie tout en vivant en compagnie d’êtres humains.
3) Le droit animalier en France et en Europe
Maintenant que la question de leur survie semble tranchée, il faut s’interroger sur la façon dont nous devons les traiter, et quels doivent être leurs droits.
Dans le droit français actuel, les animaux domestiques en général ont vu leur statut juridique progressivement évoluer depuis 1850 et la loi Grammont, qui punissait d’ « une amende d’un à cinq franc », et même « d’un a cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Le caractère visible des mauvais traitements souligne que ce ne sont pas tant les animaux que la sensibilité des être humains que l’on a voulu ainsi protéger. Cette clause de publicité sera supprimée en 1959 seulement, et en 1963 une loi crée le délit d’acte de cruauté envers les animaux domestiques, qu’ils soient commis en public ou non. Remarquons, comme le fait Florence Burgat dans Être le bien d’un autre, que « les animaux sauvages furent explicitement exclus de ces mesures, et ils le demeurent ». Leur existence représente en effet un vide juridique, et vous ne risquez rien si vous décidez de torturer des renards dans votre jardin.
En 1976, une loi relative à la protection de la nature va plus loin en affirmant que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Ce statut est ambigu, car l’animal est défini comme un être sensible que l’on ne peut pas traiter n’importe comment, et en même temps il demeure un bien possédé par un propriétaire humain. Cette ambiguïté est confirmée par la récente loi de 2015 qui modifie la définition même de l’animal dans le code civil. Il était auparavant considéré comme un « bien meuble ». Désormais « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens ». Notons que la stricte application de la loi de 1976 suffirait en principe à abolir l’élevage industriel, l’expérimentation animale, et même les cirques avec animaux et les zoos, puisqu’elle s’applique aussi à tous les animaux « tenus en captivité ». Mais évidemment dans la pratique, c’est le droit d’utiliser des animaux « soumis au régime des biens », qui reste prioritaire dans l’interprétation de ces lois.
Mais ces statuts très généraux sur les animaux domestiques ne spécifient pas le sort réservé aux animaux de compagnie, à la différence des animaux d’élevage par exemple. La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée en 1987 et ratifiée par la France en 2003, apporte des précisions importantes sur nos devoirs envers eux. Elle stipule notamment que nul animal ne doit être maltraité ou abandonné ; que tout propriétaire se doit de respecter les « besoins éthologiques » de son animal conformément à son espèce ; que le dressage n’est concevable que s’il est compatible avec le bien-être de l’animal, etc. Le texte apporte des limites aussi à la possibilité d’exploiter les animaux dans des spectacles, publicités ou autre, et interdit toute mutilation (dents, griffes par exemple) qui ne serait pas curative – sachant qu’empêcher la reproduction de son animal est également considéré comme une façon de le soigner. La Convention constitue donc une avancée importante, avec cette réserve près qu’aucune mesure concrète n’est prévue pour faire respecter efficacement les principes qui y sont joliment énoncés.
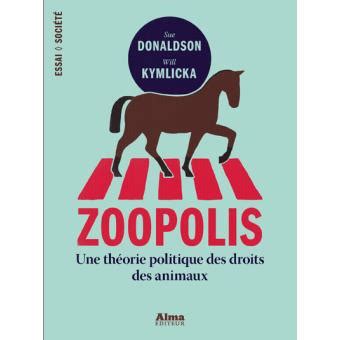
4) Quels nouveaux droits pour les animaux de compagnie ?
Au-delà des textes de lois actuels, il faut donc approfondir la réflexion théorique sur les droits que nous devons attribuer aux animaux de compagnie.
Le premier texte philosophique sérieux à prendre en charge cette question est l’article de 1998 du philosophe américain Keith Burgess-Jackson, « Doing right by our animal companions » (non traduit en français). Son argumentaire entend montrer que, outre les devoirs que nous avons envers tout animal en tant qu’être sensible, et qui sont des devoirs négatifs du type : ne pas tuer, ne pas enfermer, etc., nous avons également des devoirs spécifiques et positifs à l’égard de nos animaux de compagnie. Pourquoi des devoirs spécifiques ? Parce que nous avons en quelque sorte une dette à leur égard. Notre relation avec eux n’est pas réciproque. Nous sommes débiteurs, parce que nous avons tout seul décidé de vivre avec eux, sans leur demander leur avis ; parce que nous obtenons un agrément, un plaisir en vivant avec eux ; et parce qu’enfin selon Burgess-Jackson c’est grâce à eux que nous apprenons à être plus attentif aux besoins d’autrui, plus empathiques. Cette dette nous oblige.
Mais quels sont les devoirs spécifiques que nous avons envers eux ? Nous sommes obligés de répondre à tous leurs besoins. Non seulement leurs besoin matériels (nourriture, abri, logement, santé, exercices physiques), mais également leurs besoins psychiques et sociaux. Le besoin d’attention, de jeux, de découvertes, d’interaction sociale. A cet égard l’auteur note que c’est une obligation pour le propriétaire d’un chien de lui faire rencontrer régulièrement d’autres chiens, car les chiens sont une espèce aussi sociale que la nôtre. Nous devons également prendre la responsabilité de la progéniture de notre animal si nous avons décidé de le laisser se reproduire, et enfin nous devons trouver de nouvelles personnes pour s’occuper de notre animal si nous ne sommes plus en mesure de le faire. Rien de très étonnant dans cet article, qui a tout de même le mérite d’assumer à fond l’idée que nous sommes absolument responsables de la satisfaction des besoins de nos animaux de compagnie.
Les suggestions de Burgess-Jackson sont largement approfondies dans Zoopolis, de Donaldson et Kymlicka (2011), qui propose une théorie libérale des droits des animaux qui fera date dans la pensée animaliste. Leur idée centrale est que les animaux domestiques en général (donc également nos anciens animaux d’élevage ou autre exploitation) doivent devenir des citoyens à part entière de notre société, et que pour cela il faut considérablement étendre le champ de leurs droits positifs. Les droits positifs relationnels vont plus loin que les droits négatifs universels du type (« aucun animal ne doit être tué pour être mangé », etc.). Ce sont des obligations imposées à la société dans laquelle ils vivent. Voici quelques-uns des droits des animaux-citoyens proposés par Zoopolis :
1) Les animaux citoyens doivent avoir droit à une socialisation, qui ne soit pas seulement un dressage en vue de satisfaire des intérêts humains, mais une véritable éducation qui leur permettre de s’épanouir dans la société mixte qu’ils forment avec les humains.
2) Ils ont droit à une liberté de mouvement et au même type d’accès aux espaces publics que les humains (parcs, magasins, restaurants, etc.).
3) Ils ont droit à la protection juridique contre les délits et crimes commis contre eux, et donc d’être défendus dans ce droit par des avocat·e·s dans des procès contre leurs agresseurs.
4) Ils ont droit de ne pas être exploités – ni leur produits ni leur force de travail – ce qui formulé positivement signifie que si on fait faire quelque chose à un animal – chien guide d’aveugle par exemple – on ne peut le faire qu’à la condition que ce chien bénéficie d’un temps libre important pour rencontrer d’autres chiens, se divertir, se reposer, etc. Voir l’article de Jason Hribal sur les revendications concernant les chiens de travail : « Jesse, une chienne qui trime » (2006).
5) Point controversé : ils ont droit à la sexualité et à la reproduction au même titre que nous. Et si contrôle de la population il doit y avoir, Donaldson et Kymlicka suggèrent que cela doit se faire de façon limitée et juste. Pourquoi pas en autorisant tout animal à se reproduire une fois avant de le stériliser. (Et pour que la justice soit pleinement non spéciste, je suggère qu’on fasse la même chose aux humains, ce que Donaldson et Kymlicka ne font pas…).
6) Enfin, et cela nous ramène à notre point de départ, ils ont droit à des soins médicaux pour être en bonne santé. Et Donaldson et Kymlicka vont assez loin ici, malgré le cadre libéral de leur pensée politique, en proposant de mettre en place un système d’assurance maladie collectif (un service public en somme) qui financerait les soins vétérinaires. Ainsi les animaux seraient rétribués de leurs nombreuses contributions à la vie en société. Cette proposition va beaucoup plus loin que les assurances actuelles qu’un propriétaire peut souscrire s’il en a les moyens et l’envie, car elle exige que tous les animaux, quel que soit leur propriétaire, soient protégés et soignés. Le droit à la santé des animaux devient en quelque sorte indépendant du bon vouloir et des moyens de son propriétaire. Contrairement à l’argumentaire de Burgess-Jackson, le droit à la santé proposé ici permet de sortir enfin la question du droit des animaux de compagnie de la relation animal/maître. Les animaux possèdent ce droit parce qu’ils sont citoyens, et non parce qu’ils sont le bien de tel citoyen humain.
Reste à déterminer qui aura l’obligation de cotiser pour financer l’assurance maladie des animaux de compagnie : seulement ceux qui vivent avec les animaux de compagnie, ou bien plus largement tous les citoyens humains de la société, parce que tous bénéficient à un titre ou un autre de la présence d’animaux dans leur vie, et parce que c’est aussi le devoir de ceux qui ne s’occupent pas d’animaux de payer pour que d’autres prennent soin d’eux à leur place. Je pencherais pour cette dernière option.
Bibliographie :
– Sue Donaldson et Will Kymlicka, Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux, 2011.
– Keith Burgess-Jackson, « Doing right by our animal companions », 1998.
– Jason Hribal, « Jesse, une chienne qui trime », 2006.
– Florence Burgat, Être le bien d’un autre, 2018.
– Janick Auberger et Peter Keating, Histoire humaine des animaux. De l’Antiquité à nos jours, 2009.
– Gary Francione : http://fr.abolitionistapproach.com/2012/07/31/animaux-de-compagnie-les-problemes-inherents-a-la-domestication/
– le texte de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a684



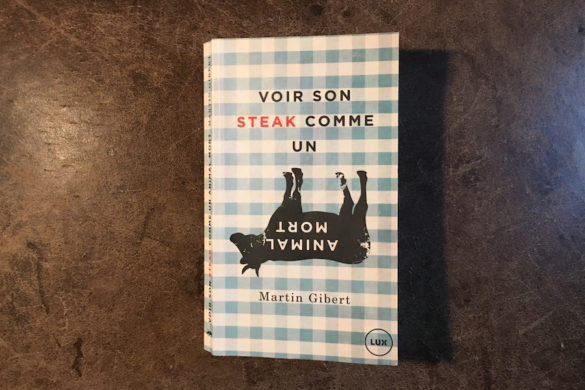


1 Commentaire
« […] je suggère qu’on fasse la même chose aux humains […] »
😍 Mais tellement 😍
Sinon merci beaucoup pour cet article très intéressant et qui va m’amener à mes prochaines lectures !